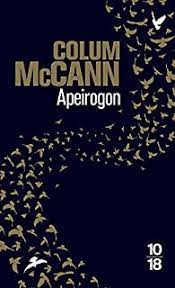Un
« apeirogon » est une figure géométrique dont le nombre de côtés
est …infini! Autant dire une figure géométrique impossible à
réaliser, un exercice mathématique sans solution concrète. En
l’occurrence, la figure géométrique en question, c‘est le
conflit israélo-palestinien. Un conflit aux multiples facettes, un
conflit dont l’issue semble impossible à trouver. Je dis bien
«semble » car les accords d’Oslo y sont presque parvenus ce qui
aurait tendance à prouver, au moins pour les indécrottables
optimistes dont je fais partie ( ceux de la volonté, pas de la
raison ) que tout est toujours possible quand des hommes de bonne
volonté se rejoignent et unissent leurs forces pour forcer le
destin.
L’auteur,
un irlandais, journaliste de profession, qui doit avoir entre 55 et
60 ans et vit à New York en famille, est mondialement connu et ses
livres atteignent des tirages faramineux ( dont « Et que le vaste
monde poursuive sa course folle »), remportant des prix du meilleur
livre étranger un peu partout, en France pour celui-là en
particulier.
Ce
livre, un pavé de plus de six cent pages est un roman imaginé
autour d’une histoire présentée comme vraie, celle de l’amitié
entre deux hommes, un israélien et un palestinien, fondée sur des
tragédies personnelles similaires : ils ont tous les deux perdu une
de leur filles : Rami Elhanan, israélien, fils d’un rescapé de la
Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour a perdu la sienne,
Smadar, dans un attentat-suicide de trois membres du Hezbollah, et
Bassam Aramin, palestinien qui a fait de longues années de prison
pour sympathie avec la « cause », a perdu la sienne, Abir, d’une
«balle perdue » d’un soldat israélien devant son école . Et
tous les deux que tout poussait, au-delà de la douleur et du deuil,
vers la haine et la vengeance, choisissent le combat pour la paix et
l’engagement dans une association transpartisane. Ils s’y lient
d’amitié.
Le
livre prend la forme d’une grande fresque s’étendant sur vingt
ou trente ans, relatée par de petits éclairages, autant de
paragraphes numérotés qui vont d’une ligne à plusieurs pages,
passant d’un des deux hommes à l’autre, d’un côté du « Mur
» à l’autre, d’une époque à l’autre avec, à l’évidence,
un parti-pris majeur: l’histoire est faite de la chose humaine et
ce conflit se traduit comme toujours par des tragédies humaines. Il
s’évade vers d’autres horizons, jusqu’à New York, convoque
des témoins divers comme John Cage ou le chanteur Prince voire
François Mitterrand ( « convoqué » à une dizaine de reprises !…
sans que je puisse en saisir le sens profond car j’ai du mal à
croire qu’il ne sache aller au-delà du fameux dernier dîner du
réveillon 95-96 autour d’ortolans,dont on sait qu’il a été
complètement « inventé » par un pseudo journaliste sans
scrupules, mais que l’auteur reprend à son compte dans un
allégorie sur le monde dans lequel nous vivons, à la fois délicieux
et…cruel !).
La
fresque est très convaincante pour son humanisme mais aussi par sa
mise en évidence de l’extrême complexité de ce conflit. Sans
subjectivité excessive ni manichéisme il démontre aussi avec
humilité l’infernal engrenage de la violence autour du lien
humiliation-violence. Convaincant aussi pour son plaidoyer pour
l’écoute, le dialogue fondé sur le respect de l’autre. Un
respect bien mal partagé dans cette région du monde. Mais, éternel
optimiste lui aussi, l’auteur défend avec conviction la thèse du
« qui aurait pu croire ? ». Qui aurait pu croire, du temps de la
Shoah, qu’Israël ait un jour une ambassade en Allemagne et ce pays
à Tel Aviv ?